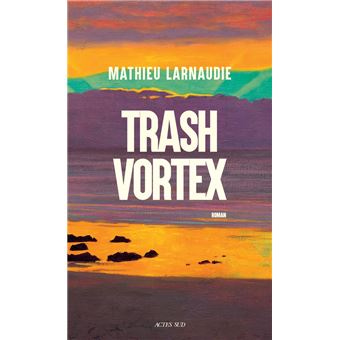Si l’on doit, à côté de la science-fiction post-apocalyptique, caractériser la « fiction pré-apocalyptique », Trash Vortex en fait assurément partie. On pourrait associer ce nouveau genre littéraire aux fameux cliffhanger des séries (à l’origine : un personnage suspendu au-dessus du vide) : quelque chose de tragique s’apprête à avoir lieu et l’émotion reste suspendue. Ce qui risque de se produire, selon « Trash Vortex » : un désastre climatique absolu, la pollution totale des océans (par le désormais tristement célèbre « continent de plastique »). Ou une autre catastrophe.
Le titre rappelle « Villa Vortex » de Maurice G. Dantec, roman inclassable, quasiment illisible, dont l’auteur eut (tout comme Mathieu Larnaudie) partie liée avec le mouvement et la revue Inculte.
Nous avons, là aussi, affaire à un roman baroque. A un roman à clés, également, pour partie au moins : on y reconnaît sans peine quelques personnages appartenant ou ayant appartenu à la macronie. L’ancien ministre de l’écologie Nicolas Hulot y est ridiculisé avec une jubilation acharnée ; l’auteur semble le penser coupable d’une plus grande trahison que les autres, dans la mesure où ses valeurs d’origine semblaient « pures » et désintéressées.
On voit aussi apparaître dans le récit un milliardaire ultraconservateur qui rachète le plus possible de médias audiovisuels pour « placer ses idées » et préparer un virage politique autoritaire, susceptible de satisfaire ses principes et, surtout, de favoriser ses affaires.
Au centre du récit, la famille Valier et son empire industriel. Au soir de sa vie, l’héritière qui le détient veut s’en débarrasser. Elle ne veut conserver pour son fils Sacha que l’entreprise Terra Viva, dont la raison sociale consiste à construire des refuges pour survivalistes richissimes, et liquider le reste dans une fondation, le Philanstère, dont l’activité devra consister, inlassablement et en y consacrant tous les moyens techniques et financiers possibles, à s’efforcer de débarrasser les océans du plastique qui les a envahis et qui menace désormais la faune et la flore dans leur ensemble et, au travers elle, la santé humaine.
Ainsi, d’un côté, on parie sur un anéantissement du monde auquel seule une toute petite partie de l’humanité pourrait échapper (les plus riches, c’est-à-dire possiblement les moins honnêtes et ceux qui ont davantage contribué à la catastrophe qu’ils fuient), d’un autre côté on s’efforce (mais non sans hypocrisie peut-être) de sauver le monde d’une menace extrême. L’auteur a-t-il bien perçu l’irréductible contradiction entre ces deux orientations ? Ou laisse-t-il à la seule perspicacité du lecteur le soin de s’en aviser ?
Il n’est pas certain en tout cas que l’intérêt premier de ce livre soit dans son intrigue, d’ailleurs peu consistante. Nous avons entre les mains un « roman de mots ». Ceux-ci se précipitent sous la plume de l’auteur, comme si c’était la seule activité possible avant l’accomplissement final, le désastre des désastres, la décomposition ultime qu’il n’est plus même question de tenter de conjurer. Puissance et verbosité alternent. On se laisse par moments emporter par le flot ; à d’autres instants on s’interroge : l’auteur n’en fait-il pas un peu trop, au point de perdre son lecteur en chemin ? Ou de s’abandonner à certains lieux communs de l’époque ? C’est ce qui fait que ce roman, malgré ses immenses qualités, laisse une impression mitigée.